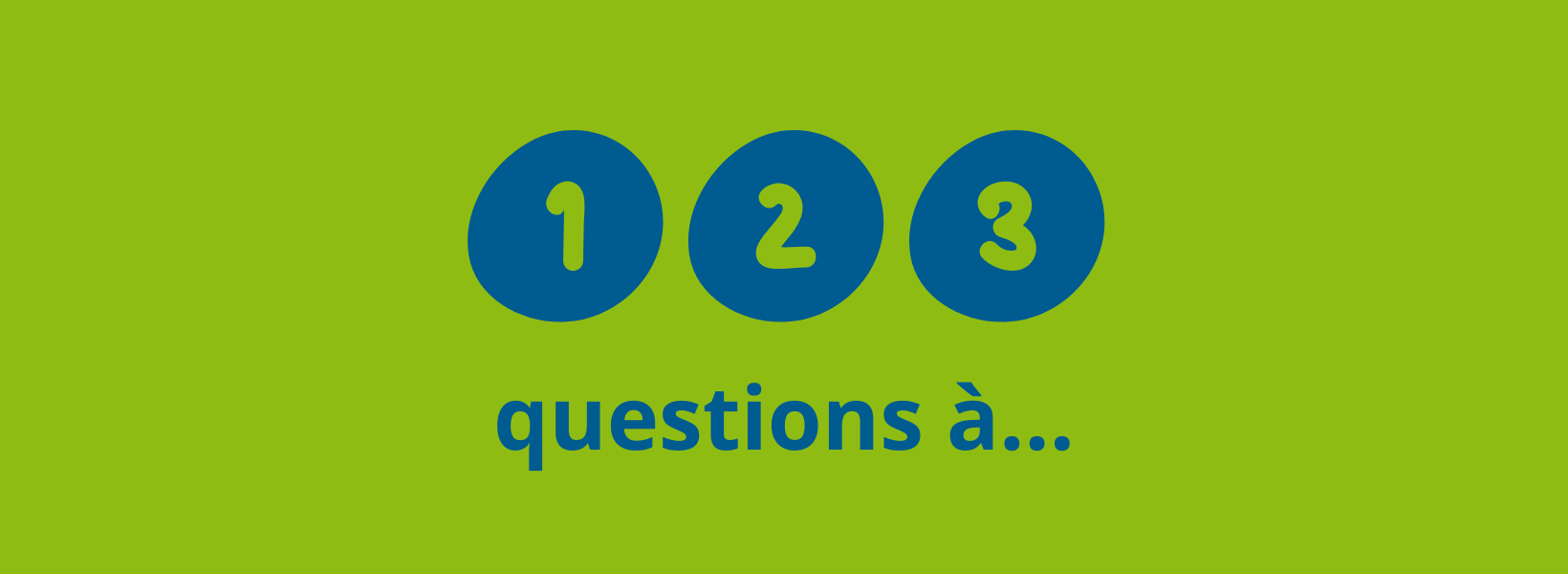Régis Cortesero est sociologue chercheur associé au laboratoire PAVE, hébergé à l’école d’architecture de Bordeaux (ENSAP). Ses sujets de recherche privilégiés : les quartiers prioritaires de la ville, les centres sociaux, la justice sociale, les discriminations et l’éducation.
Ce sont les seuls acteurs locaux, qui ne soient pas idéologiques ou militants, qui prennent en charge cette question de la conflictualité. S’ils disparaissent, plus personne ne le fera et cela engendrera très probablement plus de phénomènes de violences.
Qu'appelle-t-on la cohésion sociale ?
La cohésion sociale c’est l’idée que c’est l’engagement des individus qui fait société, c’est une conception qui met au centre la notion de lien social. Elle contribue à assurer un bien être économique, social, culturel pour construire une société solidaire et coresponsable. Elle apparaît dans les années 80, au moment du tournant néolibéral et remplace une autre conception “concurrente”, celle de l’intégration. Dans la notion d’intégration, la société préexiste aux individus et implique des droits et des devoirs réciproques pour les citoyens et les institutions. Par exemple, la contribution sociale des travailleurs fonde un droit à l’assurance chômage, maladie, retraite, etc. Dans la notion de cohésion sociale, rien n’oblige personne car rien n’est antérieur à l’action des individus. L’individu n’a pas de droit absolu et l’enjeu principal est sa mise en action, comme dans le RSA ou les réformes récentes de l’assurance chômage, où la mobilisation de l’individu prime sur ses droits.
Quelle est la place et la plus-value de la cohésion sociale
dans notre société actuelle ?
Elle permet de maintenir un certain niveau de protection, et de repenser la pratique démocratique en mettant l’accent sur l’engagement et la solidarité d’une part et sur la dimension délibérative de la démocratie d’autre part. Une des plus-values réside dans le renforcement de l’action publique de proximité ; elle permet de rapprocher les institutions publiques des citoyens. Mais elle a tendance à exclure d’autres représentations comme celle du conflit, parce qu’elle valorise le consensus, alors que le conflit est inhérent à la vie sociale. Le conflit c’est construire une société pacifiée en gérant politiquement les tensions sociales. On a tendance à associer conflit à violence mais c’est en fait ce qui permet d’éviter la violence par sa prise en charge politique, par la recherche de compromis.
En quoi les centres sociaux ont un rôle à jouer sur ces questions ?
Ce qui est très intéressant dans les centres sociaux c’est qu’ils participent de toutes ces perspectives. Ils refusent de renoncer aux autres référentiels (du conflit, de l’intégration…), quand celui de la cohésion sociale semble hégémonique dans nos pratiques et nos politiques sociales. Les centres sociaux sont de précieux équipements de proximité. C’est un des seuls réseaux nationaux à la fois coordonné et généraliste engagé dans la cohésion sociale à l’échelle locale. Ce sont des instruments de soutien et de développement du lien social. Pour autant, les centres sociaux ne renoncent ni à leur vocation éducative ni à celle de constituer des espaces politiques. Le travail autour du développement du pouvoir d’agir des habitants, par exemple, relève parfois
de la conception conflictuelle. Ce sont les seuls acteurs locaux, qui ne soient pas idéologiques ou militants, qui prennent en charge cette question de la conflictualité. S’ils disparaissent, plus personne ne le fera et cela engendrera très probablement plus de phénomènes de violences.
Les centres sociaux sont des instruments de soutien et de développement du lien social.